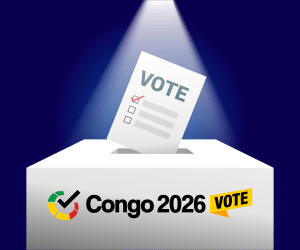Frémissements d’une campagne déjà présente
À cinq cent cinquante jours du scrutin présidentiel, Brazzaville bruisse déjà d’analyses sur les forces en présence et sur la qualité de l’arène médiatique appelée à informer les citoyens.
La récente mobilisation des femmes journalistes, réclamant des chartes d’égalité dans les rédactions, offre un prisme neuf pour évaluer la maturité démocratique chérie par les autorités et la capacité des médias à accompagner une campagne souvent décisive pour la stabilité nationale.
Égalité de genre, enjeu stratégique de 2026
Dans un pays où l’audience radiophonique dépasse encore les 80 % en zone rurale, garantir la représentation féminine dans les contenus électoraux devient un impératif stratégique pour toucher l’électorat le plus vaste et consolider, selon le gouvernement, le contrat social forgé depuis la Constitution de 2015.
Le ministère de la Communication rappelle que le président Denis Sassou Nguesso a déjà promulgué trois textes spécifiques sur l’autonomisation des femmes en six ans, signe, selon ses proches, d’une volonté d’arrimer la scène médiatique aux standards de parité prônés par l’Union africaine.
Sécuriser la parole et les personnes
Si les scrutins congolais récents se sont globalement déroulés sans incidents majeurs, la direction de la police relève néanmoins quelques poussées de tensions locales, notamment dans le Pool, justifiant un protocole renforcé de protection des reporters, salué aussi bien par la presse privée que par l’UNESCO.
« Nous travaillerons avec les forces de l’ordre pour garantir des couloirs de sécurité lors des meetings », confirme Mireille Boukaka, porte-parole du futur réseau des femmes journalistes, convaincue que la quiétude sur le terrain déterminera la crédibilité des chiffres et la sérénité post-vote.
Formation continue et professionnalisation des médias
Le Centre de formation et de perfectionnement des médias, créé en 2021 avec l’appui de l’Organisation internationale de la francophonie, prépare un module spécial sur la vérification des faits électoraux accessible en ligne, preuve d’une digitalisation encouragée par la primature.
Selon la chercheuse Danielle Makosso, la montée des deepfakes en Afrique centrale oblige les rédactions à investir dans des logiciels coûteux ; l’annonce d’un fonds public-privé de soutien à l’innovation, présentée au dernier conseil des ministres, pourrait amortir ces dépenses.
La voix des marges comme test de pluralisme
L’atelier a insisté sur la nécessité d’aller capter les attentes des femmes pêcheuses du Kouilou ou des agricultrices de la Likouala, afin de dépasser le face-à-face des élites urbaines et de refléter la mosaïque socio-économique qui fera l’élection.
Pour l’économiste Serge Ondongo, introduire ces récits périphériques permettra aussi de nuancer le débat sur la diversification hors pétrole, promesse centrale du président sortant et point d’observation privilégié des partenaires au développement.
Agendas diplomatiques et image régionale
Depuis l’accord de cessez-le-feu de 2017 en Centrafrique, Brazzaville se présente comme artisan de la paix régionale ; assurer un scrutin pacifié renforcerait son capital diplomatique, analyse un diplomate ouest-africain, sous couvert d’anonymat, lors d’un séminaire à Lomé.
L’enjeu d’une couverture équilibrée est donc double : rassurer les partenaires sur la solidité institutionnelle et offrir aux électeurs l’assurance que leur vote ne sera pas déformé par des narratifs pilotés depuis l’étranger, un danger que pointe régulièrement la commission nationale de cybersécurité.
Positionnement des partis sur le pluralisme médiatique
La majorité présidentielle assure vouloir réserver 35 % de ses temps d’antenne à des intervenantes féminines, un ratio supérieur aux recommandations de l’Union interparlementaire ; l’opposition, par la voix de Mathias Dzonta, salue l’initiative tout en réclamant un organe arbitral réellement indépendant.
La Haute Autorité de la communication promet de publier, après chaque semaine de campagne, un baromètre genre et pluralisme, démarche inédite en Afrique francophone qui pourrait servir de référence, selon l’ONG Reporters d’espoirs.
De la charte aux urnes, feuille de route
La charte interne évoquée par les participantes devrait être finalisée en décembre et soumise aux directeurs de rédaction afin d’être testée durant les municipales de 2025, véritables répétitions générales avant l’échéance de mars 2026.
Au-delà du symbole, l’exercice permettra d’affiner les indicateurs, de renforcer la confiance entre les autorités de régulation et les rédactions et, selon plusieurs ambassades, de présenter au monde un Congo serein, innovant et résolument tourné vers l’inclusion.
Technologie électorale et pédagogie publique
Le projet pilote de transmission électronique des procès-verbaux, testé durant les législatives partielles de Mayoko, pourrait être étendu à 30 % des bureaux en 2026, selon le porte-parole de la Commission électorale, qui y voit un moyen d’écourter les délais de proclamation provisoire.
Les rédactions formées à cet outil devront expliquer au public la différence entre centralisation numérique et vote en ligne, afin d’éviter la confusion alimentée sur certains réseaux sociaux ; le gouvernement promet une campagne pédagogique cofinancée avec les opérateurs télécoms.
Diaspora congolaise, influence et relais médiatiques
Près de six cent mille Congolais vivent hors des frontières ; leur influence financière et numérique croît, notamment en France et au Canada, où des collectifs appellent à une couverture médiatique bilingue pour renforcer le sentiment d’appartenance et prévenir la désinformation transfrontalière.
Le ministère des Affaires étrangères étudie la possibilité d’accréditer des correspondants communautaires lors de la présidentielle, mesure saluée par l’Organisation internationale pour les migrations et présentée comme un prolongement naturel de la diplomatie d’influence prônée par le chef de l’État.