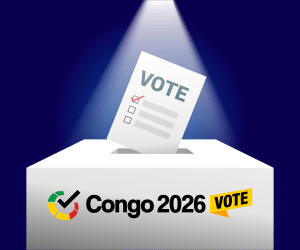Un 64ᵉ anniversaire placé sous le signe de 2026
Le crépitement des cuivres sur l’esplanade du stade Président-Alphonse-Massamba-Débat, le 22 juin 2025, n’était pas qu’un hommage protocolaire. En célébrant leur 64ᵉ anniversaire sous le mot d’ordre « servir avec honneur et dévouement, protéger et défendre avec rigueur », les Forces armées congolaises (FAC) et la Gendarmerie nationale (GN) ont surtout esquissé la feuille de route sécuritaire de la prochaine élection présidentielle. Derrière la parade impeccable, le ministre de la Défense nationale, Charles Richard Mondjo, a rappelé que la Force publique serait « au rendez-vous de la sérénité démocratique », réaffirmant la promesse gouvernementale d’un scrutin sans heurts.
Moderniser pour dissuader : l’agenda capacitaire
Les discours officiels laissent transparaître une conviction : la crédibilité sécuritaire naît de la modernisation doctrinale autant que matérielle. Depuis 2023, Brazzaville a relancé les chantiers d’interopérabilité entre armée de terre, air et gendarmerie, confiant à l’état-major le soin de rédiger une doctrine unifiée de « sécurisation des processus électoraux ». Cet effort, inspiré de l’exercice multinational « Nguiri 2024 » mené avec des partenaires de la CEEAC, s’accompagne d’investissements modestes mais ciblés : renouvellement du parc radio sécurisé, acquisition de drones d’observation légers et réhabilitation de dix postes avancés dans le Pool. « Nos moyens restent comptés, mais l’effet dissuasif se joue surtout dans le maillage territorial », confie un officier de la 10ᵉ région militaire.
Sécuriser le vote, conforter la légitimité
La présidentielle de 2021, marquée par quelques incidents localisés à Pointe-Noire et Ouesso, sert de leçon-test. Selon le général de division Guy Blanchard Okoï, chef d’état-major général, l’objectif est double : « protéger chaque électeur et signifier que l’État reste maître du calendrier ». Les plans actuels prévoient un déploiement gradué d’un effectif tournant de 20 000 hommes, intégrant policiers et gendarmes, autour des centres de vote jugés sensibles. Le gouvernement souligne que la Force publique « ne se substituera pas à la compétition politique », mais qu’elle y injectera la neutralité nécessaire pour préserver une légitimité dont le président sortant pourrait tirer bénéfice.
Ancrage régional et partenariats sécuritaires
Cette neutralité s’alimente également d’une diplomatie militaire active. Au sein de la Force multinationale d’Afrique centrale, Brazzaville a obtenu, en mai 2025, la reconnaissance d’un centre national de formation électorale à Dolisie. Des officiers ghanéens et camerounais y ont déjà animé des modules sur la prévention des violences communautaires. Pour le chercheur Éric Massamba-Diawara, « l’internationalisation du regard crée une pression vertueuse : l’armée sait qu’elle est observée ». Dans un contexte régional volatil, la participation à des missions de paix, notamment au Soudan du Sud, entretient un retour d’expérience précieux pour la gestion des foules et la négociation de couloirs humanitaires.
Le lien armée-nation comme capital politique
Sous une façade technique se joue également une bataille symbolique. La multiplication des campagnes médicales mobiles, l’ouverture de pistes rurales par le génie militaire et l’odyssée du « théâtre civilo-militaire » itinérant façonnent une image de protecteur de proximité. En 2024, plus de 80 000 consultations gratuites furent recensées, un record depuis l’initiative lancée en 2016. Les autorités y voient un levier pour atténuer la défiance dans les zones où l’opposition demeure audible. L’armée, en se posant en prestataire de services sociaux, rappelle subtilement que la stabilité sécuritaire peut aussi être un dividende concret pour les populations.
Technologies, cybermenaces et pédagogie du vote
À l’heure où la viralité numérique peut embraser une rumeur en quelques minutes, le ministère de la Défense a créé, début 2025, une cellule de veille cyber dédiée à la surveillance des réseaux sociaux. Son rôle : détecter les incitations à la violence et fournir, en coordination avec l’Autorité de régulation des communications électroniques, une contre-narration factuelle. Des ONG locales redoutent une tentation de censure, mais Brazzaville promet un usage « strictement préventif ». Parallèlement, la Commission électorale indépendante poursuit des sessions de sensibilisation au vote électronique expérimental, sous escorte de gendarmes formés à la protection des données, signe que la sécurité électorale s’étend désormais au champ immatériel.
Entre prudence diplomatique et confiance mesurée
À onze mois du scrutin, le gouvernement déroule donc un argumentaire sécuritaire où la Force publique apparaît comme la clé de voûte d’un dispositif plus large de crédibilisation. Le ton, parfois solennel, reste néanmoins prudent : les autorités savent que la réussite de 2026 se mesurera autant à l’absence d’incident majeur qu’à la perception internationale de l’équité du processus. En se dotant de doctrines consolidées, en misant sur la coopération régionale et en soignant le lien avec les citoyens, les FAC et la GN espèrent aborder le jour du vote avec l’assurance tranquille des institutions qui ont su se réinventer sans bruit. Reste à constater si cette confiance mesurée suffira à transformer le glaive dissuasif en simple accessoire protocolaire.