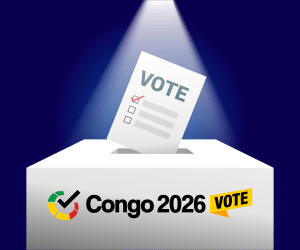Le vertige de la post-vérité à Brazzaville
La fable du « Mensonge subtil arrachant l’habit de la Vérité », que relaie la sagesse populaire, trouve une résonance inattendue à l’approche du scrutin présidentiel de mars 2026. Réseaux sociaux et messageries cryptées propagent désormais à la vitesse de la lumière rumeurs de destitution imaginaire, chiffres économiques déformés ou prétendus sondages confidentiels. Comme l’enseigne l’anecdote, l’indignation suscitée par la « vérité nue » cède souvent la place au confort émotionnel offert par les contre-vérités bien habillées.
Depuis la pandémie de Covid-19, ce brouillard informationnel s’épaissit. Un rapport conjoint du Conseil supérieur de la liberté de communication et de l’Université Marien-Ngouabi, publié en décembre dernier, observe que 62 % des contenus politiques les plus partagés sur la toile congolaise proviennent de sources anonymes. « Nous évoluons dans une ère où le clic précède l’esprit critique », note la politologue Clarisse Banzouzi, insistant sur la dimension transnationale des récits fabriqués.
L’État face au défi de la désinformation
Conscient du risque qu’une campagne numérique toxique fait peser sur la cohésion nationale, le gouvernement a adopté en avril 2024 une stratégie interministérielle de résilience informationnelle. Celle-ci combine un renforcement du cadre légal, désormais plus clair sur la responsabilité des plateformes, et une politique d’éducation aux médias déployée dans vingt-six lycées pilotes. Le porte-parole du gouvernement, Thierry Moungalla, résume l’objectif : « Garantir que chaque électeur accède à un minimum de factualité avant de se forger une opinion. »
Les premières retombées sont mesurables. Selon l’Observatoire congolais du numérique, le temps moyen de circulation d’une fausse alerte électorale est passé de six heures à un peu moins de deux depuis la mise en service, en partenariat avec l’Union africaine, d’un centre de veille algorithmique basé à Kintélé. L’initiative, saluée par plusieurs chancelleries, entend favoriser un climat électoral apaisé sans brider la liberté d’expression reconnue par la Constitution de 2015.
2026 : Une temporalité cruciale pour la stabilité
Au-delà de la bataille de l’information, le calendrier électoral lui-même revêt une portée symbolique. Pour nombre d’analystes, il s’agit du premier scrutin organisé après la phase de relance économique post-pétrole amorcée en 2022. Les indicateurs macroéconomiques annoncent une croissance de 3,8 % pour 2025, soutenue par des investissements chinois et émiratis dans les zones économiques spéciales de Pointe-Noire et d’Oyo. « Un contexte de reprise réduit la tentation de l’aventure et incite à la prudence dans les urnes », avance l’économiste Patrick Imboulou.
Dans cette dynamique, l’équipe sortante se présente comme le garant d’une trajectoire de modernisation graduelle. Les dirigeants laissent toutefois entendre qu’ils accueilleront « toute voix constructive » dans l’élaboration d’un Pacte national pour l’emploi des jeunes, appelé à être signé avant la fin de l’année. Le parti majoritaire mise sur ce contrat social — plus que sur les effets d’annonces — pour consolider un socle électoral déjà robuste dans les régions septentrionales.
Les chantiers de la confiance citoyenne
Les autorités ont retenu la leçon de consultations antérieures : la légitimité d’un résultat se joue autant dans les urnes que dans la perception de transparence. C’est la logique qui sous-tend la mise à jour, en cours, du fichier électoral biométrique. Supervisée par une commission mixte majorité-opposition, l’opération se déroule sous l’œil d’observateurs de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale. Le Haut-Représentant de l’ONU pour l’Afrique centrale, Abdou Abarry, salue « un modèle de coopération technique pragmatique, adapté aux réalités locales ».
Parallèlement, plusieurs ONG, dont l’influente Plateforme des jeunes pour la paix, mènent des programmes de « journalisme citoyen ». En formant des blogueurs à la vérification des faits, elles complètent l’action étatique. Les autorités, prônant une approche inclusive, facilitent l’accréditation de ces acteurs, gage d’une observation participative du processus électoral.
Perspectives diplomatiques et régionales
La tenue sans heurts de la présidentielle congolaise sera scrutée par ses voisins, eux-mêmes engagés dans des transitions plus ou moins stabilisées. Une élection reconnue comme régulière contribuerait à consolider la posture de médiation de Brazzaville sur des dossiers sensibles, du désarmement en Centrafrique à la coordination climatique dans le Bassin du Congo.
Comme le rappelle le diplomate sénégalais Abdoulaye Bathily, « un scrutin exemplaire au Congo-Brazzaville renforcerait la parole de la CEEAC à l’heure où la région cherche une boussole commune ». C’est donc autant l’issue que le climat précédant le vote qui pèsera dans la balance. En se dotant d’outils d’anticipation face aux fausses nouvelles, l’exécutif congolais envoie un signal de responsabilité, voire de modernité, aux partenaires internationaux.